PROJET ...DOUANIERS

Quelques notions sur les douaniers
Article publié sur "Votre Généalogie" numéro
11, "Douanes et douaniers", par Paul Povoas (fév./mars
2006)
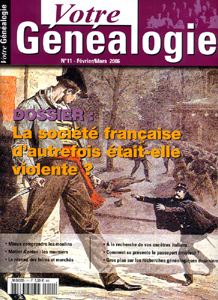
Douanes et douaniers
par
Paul Povoas
L’histoire et la généalogie douanières, voilà un sujet à la fois
complexe et passionnant, tant il est difficile d’appréhender l’organisation et les
usages de cette administration multiséculaire.
Des générations d’hommes imprégnés du devoir ont servi les intérêts de la nation : au rythme des événements historiques, des campagnes
contre les contrebandiers et la fraude , leur
mission de douanier impliquait l’adoption
d’un mode de vie contraignant voire dangereux, si bien qu’un certain nombre
d’entre eux ont payé de leur
vie.
Et de nos jours, la recherche généalogique douanière se
trouve facilitée grâce au Musée
national de la Douane chargé de promouvoir l’histoire et la généalogie douanières.
Un peu d’Histoire
Une lente organisation
Si l’exercice des droits sur les « entrées »
et les « sorties » est une préoccupation du pouvoir monarchique,
ces droits de douane intérieure
se confondent au Moyen-Age avec les taxes de péage, de circulation et par
la suite de l’octroi.
Ces droits et taxes sur les marchandises, différents d’une province à l’autre,
sont régis et affermés isolément.
En 1598, Sully réunit ces taxes
en un seul et unique prélèvement, connu
sous le nom de « bail des cinq grosses fermes ». L’utilité économique
des droits de douane encourage ainsi le commerce et protège les manufactures
nationales.
En 1614, les douanes intérieures sont en partie supprimées. On instaure
trois parties distinctes sur l’ensemble du territoire :
- une partie du royaume acceptant la liberté commerciale et appliquant les « cinq grosses fermes ».
- une autre partie regroupant les « provinces réputées étrangères »,
conservant leurs propres douanes intérieures.
- une zone dénommée « l’étranger effectif » ou « à l’instar
de l’étranger effectif », pouvant
exercer ses droits d’échange librement vers l’extérieur mais sans communiquer
avec le reste du royaume : En faisaient partie l’Alsace, la Lorraine
et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, et quelques villes portuaires :
Bayonne, Lorient et Dunkerque, pour n’en citer que quelques unes.
Vers une unification des droits douaniers
Au milieu du XVII ème siècle, Colbert, alors Contrôleur général des Finances
de Louis XIV, considéré comme le fondateur de la douane moderne, développe
le commerce et prétend par sa doctrine inspirée du mercantilisme libéral que les échanges commerciaux,
notamment les exportations vers l’étranger, peuvent enrichir le Trésor royal.
Si bien que des mesures ont été instaurées avec l’abolition des douanes
intérieures, le développement et la protection
des manufactures assurant ainsi leur essor grâce aux exemptions fiscales
et aux subventions royales. Les
produits étrangers, hollandais et anglais notamment, lourdement taxés,
subissent le protectionnisme
français, qui conduira en toute évidence à la guerre.
La doctrine de Colbert prévaut jusqu’à la fin du l’Ancien régime ;
les deux ordonnances de 1681 et 1687 lancent les bases de la législation
douanière moderne, avec l’élaboration d’un tarif douanier homogène, le transfert
des bureaux de traites aux frontières et la suppression des barrières intérieures.
Il est à noter que le pouvoir central s’est heurté à certains bénéficiaires
tels les fermiers généraux qui
jouissaient de « privilèges » et s’étaient considérablement enrichis
grâce notamment à des droits comme la Gabelle, impôt sur le sel,
très impopulaire.
Si bien qu’à cette époque la Ferme Générale
compte plus de 40 directions en province et recense 25 000 agents agissant
« Au nom du Roi », sans être pour autant des fonctionnaires royaux,
un effectif occupé pour une partie
dans les bureaux de traite à
percevoir et vérifier les droits encaissés, et l’autre, la plus importante,
les « brigades », en fait, les employés des fermes du Roi, pour
le contrôle des marchandises et la répression de la contrebande.
L’administration des Douanes moderne naît avec la Révolution et précisément
sous la Constituante, avec la loi du 1er mai 1791, qui fonde
la Régie des Douanes nationales. Des mesures coercitives s’appliquent sur
les modes de perception des droits d’entrée et de sortie du territoire national.
La gabelle, les barrières intérieures et la Ferme Générale sont supprimées.
L’uniformisation d’un tarif douanier unique est instauré, sans pour autant
réellement changer l’organisation des effectifs,
soit près de 15 000 agents, dès lors sous les ordres d’anciens fermiers
généraux, devenus hauts fonctionnaires. En 1795, la Régie est supprimée
pour devenir l’Agence nationale des Douanes.
Sous le Premier empire, la Douane est organisée militairement. Les territoires
provenant des conquêtes napoléoniennes déplacent des douaniers jusqu’aux confins de l’Europe napoléonienne, dont les
frontières sont totalement verrouillées en raison du blocus. Il arrive que des agents des douanes impériales
excercent dans des territoires éloignés
et il n’est pas rare que quelques uns d’entre
eux y fondent une famille avant de revenir ensuite en France. Cela complique
bien sûr les recherches généalogiques.
La douane moderne
L’aventure coloniale dans le courant du
XIXème siècle, et la consolidation de l’Empire français, établi en
Afrique, aux Antilles, en Asie, en Océanie, à
Madagascar et finalement en Indochine, confirment
le rôle capital de la Douane, qui s’appuie sur les administrations
locales, acquises aux mêmes méthodes.
L’assouplissement douanier, opéré dès 1860, avec une politique économique
basée sur le libre-échange, accentuée par la généralisation des moyens de
transport, comme le chemin de fer et la navigation à vapeur, occasionne des variations dans les échanges internationaux, si bien qu’il faut attendre l’issue de la 2ème
Guerre Mondiale et les années 50 pour libéraliser les échanges commerciaux.
La France, en tant que membre fondateur du Conseil de Coopération douanière,
s’engage avec la construction européenne dans le processus qui conduira
à la disparition des frontières fiscales en 1993.
Qui sont ces douaniers ?
Nombreux sont les généalogistes qui disposent
d’ancêtres employés dans les douanes et suivent bien souvent difficilement
leur pérégrinations, d’autant que toute carrière dans la douane exige
une mobilité bien évidente. Dans le milieu généalogiste, on prétend même
qu’un douanier doit exercer sa profession avec la plus grande impartialité,
si bien qu’on le trouve souvent originaire d’une autre région, et on ne
cache pas que cela évite d’entretenir par conséquent une certaine compassion
avec la population locale, vis à vis de laquelle il n’a évidemment aucune
affinité familiale.
A quoi reconnaissait-on les douaniers ? Au
XVIII ème siècle, les « employés des fermes du roi » ne
revêtaient pas d’uniforme. En fait, vêtus
simplement et parfois disposant d’armes rudimentaires et de moyens qui leur
sont personnels, ils exerçaient leur métier avec grande vigilance tant les
dangers étaient réels, surtout lors des déplacements de jour comme de nuit,
car, des heurts violents survenaient parfois entre
douaniers et contrebandiers armés et déterminés.
Ce n’est qu’à partir du Consulat que les douaniers sont enfin reconnaissables
avec un uniforme propre à leur administration.
Il faut attendre la Restauration pour que l’uniforme devienne d’usage
pour les brigades de la surveillance. Si, au premier abord, il peut
paraître étonnant que des fonctionnaires civils soient dotés d'un uniforme,
cela s'explique par la volonté et la nécessité de
se faire reconnaître pendant leurs missions.
Les douaniers étaient
issus de toutes les couches sociales et être douanier suscitait vocation :
il n’est donc pas rare d’en dénombrer plusieurs dans la descendance d’une
même famille. D’anciens militaires, en fin d’activité, sollicitaient leur
intégration dans les brigades actives de la douane et, forts de l’expérience acquise pendant les guerres,
ces douaniers menaient de vrais combats contre la fraude et les contrebandiers.
Si les conditions de travail étaient difficiles et exigeaient une totale soumission aux supérieurs, les douaniers étaient
reconnus pour accomplir leur devoir et pouvaient espérer des avancements voire des
distinctions.
On reconnaissait généralement le douanier à
sa grosse veste gris-vert et à son pantalon bleu céleste bordé du galon rouge
garance, il était donc repérable lorsqu’il
faisait sa ronde à pied accompagné de collègues, par des itinéraires destinés
à surprendre les contrebandiers et les fraudeurs. Chaque brigade avait une
zone nommée « penthière » (en fait, une zone de terrain dont une
brigade des douanes devait assurer la surveillance).
Il n’était pas rare que des chiens accompagnent les douaniers.
Les bêtes dressées portaient parfois
des colliers armés de « piques » pour blesser les chiens de fraudeurs
et pour empêcher qu’on les attrapât à la gorge.
Les douaniers partaient souvent pour plusieurs jours ; outre le fusil
et la soude destinée à rechercher les marchandises cachées dans des ballots
de paille ou dans tout
autre transport de fourrage ou légumes, ils portaient sur leur dos leur
« lit d’embuscade » qui leur permettait de s’installer aux points
stratégiques sur le passage des fraudeurs (comme les dunes, les voies ferrées,
la plage ou les forêts).
Bel exemple ce passage tiré dans « Histoires et Traditions du Doubs »,
« Dans ces sentiers perdus,
on se croyait à l'abri des «loups» - sobriquet donné aux douaniers -
mais, en rase campagne, on n'en menait pourtant pas large. Les yeux écarquillés,
l'oreille aux aguets, on avançait à pas de loup ! Pris, on était délesté
de la moitié de votre bricotte (petite contrebande), ou parfois conduit au bureau, pour fouille...C'est là, à ces bureaux,
que les agents viennent régulièrement, près du brigadier, prendre, dans
le plus grand secret, leur ordre de service, de jour en campagne, de nuit
en embuscade. On les voit deux par deux partir, à la tombée de la nuit,
bagnoles au dos, canne en main, rejoindre leur poste d'observation où ils
peuvent être rebattus à toute heure par les chefs... Il ne s'agit pas d'en
faire à sa guise, pour le meilleur... Aussi, sur la bagnole dépliée et fourrée
de peaux de mouton, à tour de rôle, l'un dort, pendant que l'autre veille !...
Si les contrebandiers de haute lignée appréhendent ces rondes nocturnes,
les hameaux isolés s'en félicitent pour leur sécurité... Aussi ne verrouille-t-on
pas les portes pour permettre aux «embusqués» de se réfugier en cas d'orage...
Peut-être, sans le savoir, côtoient-ils les ballots de tabac ou les trousses
de café : contrebandiers de tous pays étant bien sûr logés à la même
enseigne ?
Les agents des douanes dans les bureaux, moins nombreux et relativement
favorisés, dépendaient de la Direction Générale. Le recrutement était essentiellement
opéré dans la bourgeoisie et d’ailleurs c’était dans cette catégorie sociale
que se dénombraient presque tous les cadres
supérieurs. Les inégalités étaient flagrantes si bien qu’il était courant
que des douaniers dans les brigades mobiles soient congédiés voire révoqués pour des
motifs tout aussi variables que le manque
de résultats, l’inactivité, la mauvaise conduite et l’insubordination.
Ces agents des brigades,
de loin les plus nombreux, étaient organisés militairement et subissaient une discipline
très stricte qui influait même au sein de leur vie privée. Les épouses et les enfants accompagnaient
le mari au gré des mutations. Et il est simple de constater qu’ils connurent tout au long
du XIX ème siècle des conditions de vie et de travail peu enviables :
doit-on évoquer par là la misère des préposés ? Comme nous le savons, les brigades comptaient bon nombre d’anciens
militaires auxquels s’ajoutaient les fils de préposés, embauchés comme demi-soldiers,
habitués aux conditions rudes du métier.
De nos jours, on parle des services
de la surveillance et d’une variété des métiers au sein de cette
administration . En effet, elle regroupe
aussi bien des unités terrestres, aériennes
que maritimes.
En somme, les douaniers sont présents aussi bien en frontière tierce (frontière
suisse, frontière maritime, aéroports, ports) qu'à l'intérieur du territoire.
La « douane volante »,
comme nous savons la nommer, est en fait la Brigade de surveillance intérieure
(BSI). Ces services sont dotés d'agents généralistes dits « piétons »
et d'agents ayant une spécialité tels que les motards, les marins, les aviateurs
ou les maîtres-chiens.
Bienvenue au Musée national de la Douane à Bordeaux
Suivez
le guide pour vos recherches généalogiques
Pour qui recherche des informations
sur l’état civil ou la carrière d’un ancêtre douanier, la première source,
qui devrait pouvoir être - en théorie - examinée, est constituée par l’ensemble
des pièces servant à la gestion du personnel ; il s’agit de trois documents :
le dossier individuel de l’agent,
la fiche individuelle de l’agent
et les anciens sommiers de signalement
des personnels. S’y ajoute une seconde source qui regroupe des archives
diverses émises par les services douaniers…dans la mesure où elles ont fait
l’objet de mesures de conservation.
Documents pour la
gestion du personnel
Le document essentiel est bien évidemment le dossier personnel
pour lequel la loi du 3 janvier 1979 sur les archives a porté à 120 ans
le délai au-delà duquel il peut être librement consulté. Pour ce faire,
encore convient-il de savoir où il a pu être déposé.
Nombre et contenu des dossiers
établis au nom d’un agent
Chaque direction des douanes où l’agent a été en poste a constitué
un dossier. Dès lors, le dossier qui contient le plus de renseignements
d’état civil est celui de la direction de recrutement ; le dossier
qui renseigne le mieux sur la carrière est celui de la direction où l’agent
a été radié des cadres (retraite, décès, démission, révocation). Pour certains
agents enfin - cadres supérieurs - , la direction générale des Douanes détenait
des extraits de dossiers.
Conservation des dossiers
Deux grandes catégories doivent être distinguées : les
agents radiés des cadres jusqu’en 1948, les agents radiés des cadres à partir
de 1948.
- Agents radiés des cadres jusqu’en 1948 :
Les dossiers des directions étaient soit conservés dans les
locaux de la direction concernée, soit versés aux Archives Départementales
territorialement compétentes. La difficulté pour le généalogiste est de
localiser le dépôt qui l’intéresse car, à plusieurs reprises, le découpage
des circonscriptions douanières a été modifié, entraînant la disparition
- temporaire ou définitive - ou le transfert de certaines directions.
Quant aux dossiers de la Direction générale, pour la période
1791 - 1871, ils ont été détruits dans l’incendie du Ministère des Finances
en mai 1871. Les fonds de dossiers de la période 1871-1948, non versés aux Archives Nationales, ont, selon
toute vraisemblance, été détruits.
- Agents radiés depuis 1948 :
Pour les agents radiés entre 1948 et 1976, les dossiers des
directions étaient soit conservés dans les directions, soit archivés à l’Ecole
Nationale des Brigades des Douanes de La Rochelle avec les dossiers de la
direction générale des Douanes.
A la suite de la décision administrative ont été acheminés
au Service des archives économiques et financières de Fontainebleau les
dossiers concernant :
- Les cadres supérieurs (agents à partir du grade de directeur
régional, ainsi que les receveurs principaux régionaux),
- L’ancien service des bureaux et l’ancien service des brigades
qui exerçaient dans les départements d’Outre-Mer,
- Les agents recrutés en Algérie avant l’indépendance,
- Les agents ayant servi dans les anciens services de la France
d’Outre-Mer.
En revanche, les dossiers des agents de l’ancien service des
bureaux et du corps des officiers des douanes ont été remis aux directions
régionales où les agents étaient affectés avant leur radiation des cadres,
pour versement aux Archives départementales compétentes.
Pour les agents radiés depuis 1976, les dossiers sont versés
progressivement, après un délai de conservation de cinq ans dans les services
douaniers, soit au S.A.E.F. de Fontainebleau - lorsqu’il s’agit des cadres
supérieurs - , soit aux Archives Départementales.
Documents divers
Au cours du XIX ème siècle et dans la première moitié du XX
ème siècle, de nombreuses directions des douanes n’ont pas effectué régulièrement
le versement des archives relatives au personnel, et notamment des dossiers
individuels, aux Archives Départementales.
De multiples dossiers ont ainsi été perdus, détruits lors de
conflits dans les directions des douanes des frontières du Nord et de l’Est
mais aussi à Rouen et à Bordeaux, ou tout simplement mis au pilon « pour
faire de la place ».
Dans des cas très particuliers, et essentiellement pour la
reconstitution de la carrière,
le généalogiste peut espérer renouer le fil dans ses recherches en consultant :
- les annuaires des douanes qui permettent de « suivre » les officiers, les receveurs et le cadre supérieur dans leur déroulement de carrière,
- les états récapitulatifs du personnel, malheureusement rarissimes,
qui précisent l’implantation géographique des agents,
- les rapports administratifs, que l’on peut trouver dans les
séries P (Finances, cadastre, poste, eaux et forêts) ou la série M des Archives
Départementales et qui évoquent parfois la situation ou l’action d’un ou
plusieurs agents.
(Sources : Catalogue de l'exposition « Jules Itier. Globe-trotteur et reporter »,
1991, Musée national de la Douane)
Le musée
En juillet 1980, le Conseil d’Administration de la Direction Générale des
Douanes se prononça pour la création d’un Musée National des Douanes et
son installation dans la « Douane » de Bordeaux.
Une bibliothèque, dont la salle de lecture jouxte le musée, a été ouverte
au public en novembre 1984 et s’efforce d’apporter la meilleure aide possible
aux généalogistes, mais elle est limitée.
En effet, lorsqu’il s’agissait d’épaves de séries détruites
ou disparues et dans la mesure où ils présentaient un intérêt muséographique,
des dossiers de personnel et des sommiers de signalement des personnels
ont été acheminés vers le musée.
Pour ce qui est des dossiers de personnel, ils concernent les
directions de Lyon et de Marseille. Quant aux sommiers, ils proviennent
des directions de Bordeaux, Dunkerque, Nantes, Bastia, Bayonne, Charleville,
Chambéry et Valenciennes.
Par conséquent, les possibilités offertes par le fonds du musée
demeurent restreintes sur le plan géographique puisque toutes les directions
ne sont pas représentées, et dans le temps car il n’appartient pas au musée
de disposer de séries complètes.
Cependant, compte tenu de la mobilité des agents des douanes,
il a paru opportun de dépouiller l’ensemble des pièces, au besoin de les
rapprocher d’archives appartenant à l’administration, pour constituer un
fichier patronymique qui permet d’accélérer le traitement des demandes des
généalogistes.
Quelles sont ces archives qui ont permis d’enrichir le fichier
patronymique ? Ce sont d’une part des documents acquis par le musée
(correspondances, dossiers, rapports), d’autre part des versements effectués
par des douaniers ou des descendants de douaniers. C’est ainsi qu’une mention
particulière doit être faite du fonds Léon Leducq qui regroupe l’ensemble
des recherches effectuées au cours de sa vie par cet ancien directeur des
douanes.
Dès lors, si le musée détient des documents relatifs à la personne
étudiée, deux possibilités s’offrent au chercheur : la consultation
sur place ou la prise en charge de la recherche par le musée contre paiement
d’une somme forfaitaire actuellement fixée à 15,25 €.
(Sources . opt.citée)
Adresse du musée : 1 place de la Bourse 33000
BORDEAUX
Téléphone : 05 56 48 82 82 / Fax
: 05 56 48 82 88
Courriel : mediation.mnd@free.fr
Bibliographie
Parmi la bibliographie,
retenons les nombreux ouvrages écrits par de Jean Clinquart sur l’administration
des Douanes en France, depuis la Révolution.
D’autres ouvrages divers
L’ administration des Douanes en France sous l’Ancien régime, par Jean-Claude
Boy (1976)
« Douaniers mis à la retraite sous l’Empire » - Répertoire nominatif
des dossiers conservés aux Archives nationales - par Gilles Mesnil –
« Directeurs et directions des douanes 1791-1945 », par Michel
Boyé et Nelly Coudier – AHAD
Sites Internet :
www.douane.gouv.fr : le site
officiel de la Douane
www.gabelou.com : le site de
l’association de l’association « gabelou.com » pour promouvoir les relations entre douaniers
et de valoriser l'image des douaniers auprès du grand public
Adresses intéressantes
Association pour l’Histoire des Douanes, Ecole nationale des Douanes,
74, Boulevard Bourdon 92200 Neuilly-sur-Seine
le Musée de la vie frontalière à
Godewaersvelde
98, route de Callicanes - 59270
- Godewaersvelde

http://www.votre-genealogie.fr
![]() Commander
la revue au format PDF avec illustration (épuisé sous format
papier)
Commander
la revue au format PDF avec illustration (épuisé sous format
papier)

 Bases GENEALO
Bases GENEALO